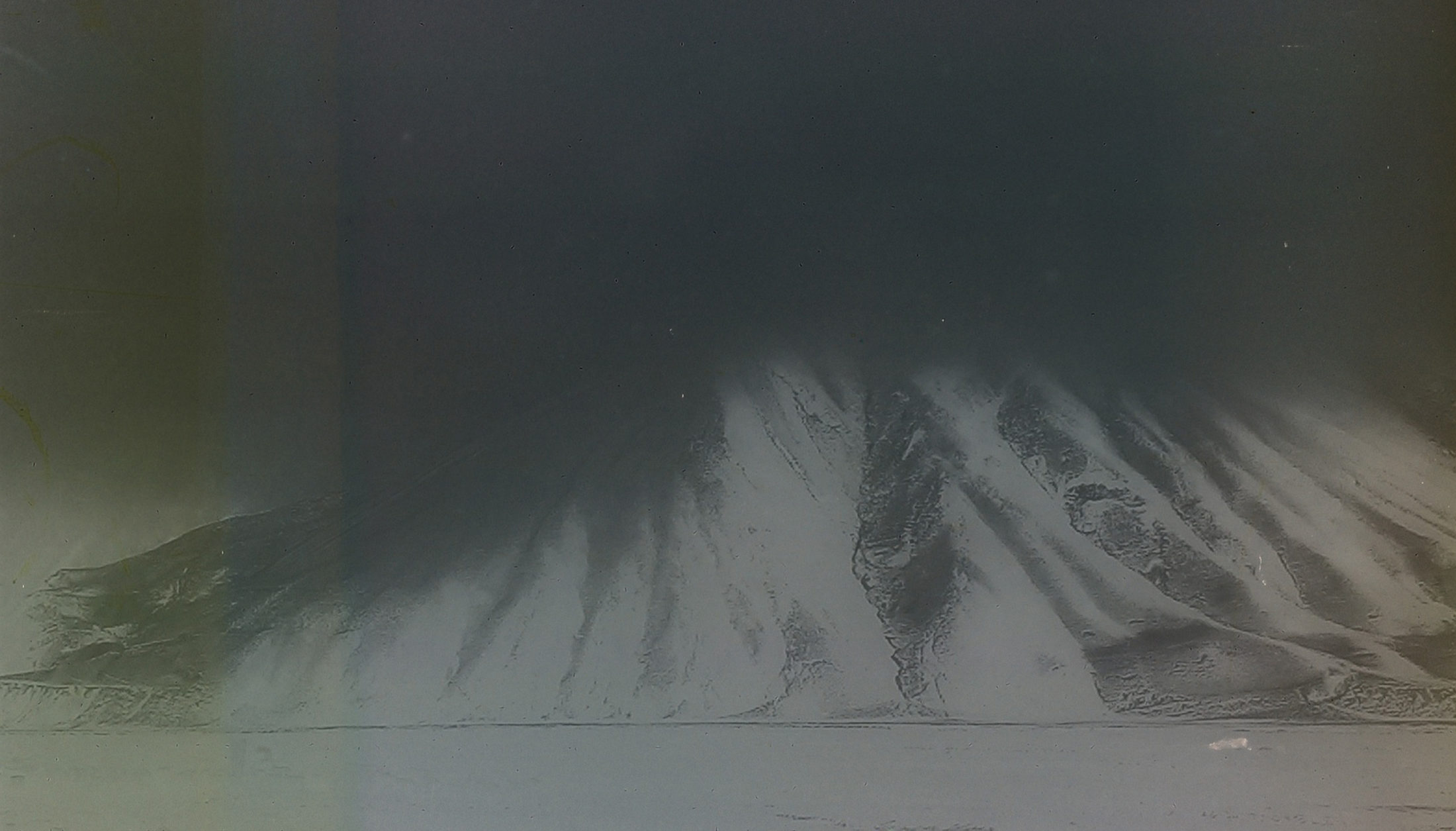Là-bas, sur les routes de l’antique royaume de l’Albanie du Caucase, une femme découvre les terres blanches et les feux éternels des terres d’Aran, là où le présent semble enfoui dans le temps.
En janvier 2015, Nilüfer Karanfil-Büyükyıldırım, architecte et photographe turque basée à Istanbul, est engagée sur un tournage à Baku, capitale de l’Azerbaïdjan, en tant qu’assistante artistique. Au cours du tournage, on lui donne pour mission d’aller repérer des maisons traditionnelles dans le village de Xinaliq, situé à 2 350 mètres d’altitude dans la province de Quba. Un lieu hors du temps où les habitants parlent une langue distincte et sont issus de groupes ethniques isolés depuis des siècles. Un lieu où le passé zoroastrien, les grottes et les feux provenant de la combustion de gaz naturels ont forgé mysticisme et légendes. Elle en a tiré une expérience singulière, à mi-chemin entre rêve et réalité.
Première
On prend la route,
Au moment où la nuit prend des nouvelles du jour ;
Le temps est glacial,
La route longue et sinueuse.
Je suis assise à l’arrière,
L’esprit encore voilé,
Regardant alentour,
Les maisons disparaissent,
Les arbres sont en ordre,
Des plastiques bleus volent à la ronde.
On s’arrête.
Une vieille cabane terrassée par le vent :
Tempête de neige.
Des rêves hurlants passent dans mon esprit
Peuplés d’arbres massifs et de colonnes nocturnes,
Parfums de ville,
Bois se consumant lentement,
Braises.
Dehors règnent les ténèbres les plus vastes que l’on puisse supporter.
Deuxième.
Je dors dans le vrombissement.
Il y a une étrange intemporalité dans l’odeur de la nuit,
Comme si rien n’avait changé.
En attendant le pas supplémentaire,
Les ombres sont trop longues,
Avec une bruine légère tombant sur mes épaules,
Mes oreilles, mon nez et le coin de mes yeux s’engourdissent.
Je me réveille dans le blanc.
Un éclat brûlant.
Nous sommes sur la route à nouveau,
Ce que je découvre un peu plus tard me coupe le souffle,
Une fine ligne sur la vallée.
L’espace d’une roue sur des routes sinueuses,
La texture change à chaque pas,
Toutes les couleurs du froid et du chaud ;
L’eau glacée étincelle sur les roches du torrent,
Des flocons comme du sable,
Je ne peux voir devant.
Le blizzard commence ;
La direction se mesure d’un pas en avant,
À un pas d’un virage.
Troisième.
Je suis les lignes,
Je ne me souviens plus où j’allais,
Ni d’où je viens à l’instant.
Les imposantes murailles de la vallée,
À la recherche du ciel ;
Espace.
Je marche sur une route sinueuse et glissante,
Je bouge ma main entre les rochers,
Les couleurs sont violettes, les couleurs sont jaunes, blanches,
Les veines de rochers s’épanouissent comme des fleurs.
Oreille de poisson ;
Je suis au pied des montagnes
Deux mille trois cents mètres au-dessus,
Je prends un coquillage dans la main.
Et un de plus,
Je pense toujours à la mer Égée, ces coquillages,
Naturellement décorés de colonnes doriques,
(Colonnes cannelées).
Arêtes, débris.
Mes iris,
S’échappant, se contractant,
Comme une tête d’épingle,
Reflet de l’esprit.
C’est un voyage vers un endroit profond.
Si éloigné qu’on ne peut le rejoindre sans savoir qu’on s’y trouve déjà,
Tellement infini,
Jusqu’à une inconnue si étroite, si fine,
Comme le soleil disparaissant dans les couleurs du crépuscule.
Maintenant la perspective de la route s’efface,
Comme si la destination avait disparu,
Et que seules les montagnes avaient bougé.
Quatrième.
Personne ne passe
Il y a le bruit des oiseaux, la faible lueur de l’eau
La route est gelée, glissante
Difficile de marcher ;
Une Neva nous dépasse – rapidement –
Un agneau décoré au henné accroché sur le toit,
Dans l’air froid, ses oreilles battent au vent.
Une autre Neva arrive vers nous maintenant ;
On s’y engouffre.
Je suis assise à l’arrière, la route est pluvieuse,
Nous roulons vite,
Cernés par la fumée de cigarette.
Je ne peux décrocher mon regard des falaises qui se déplacent,
Ma respiration voile la fenêtre,
Comme si tout assombrissait le visage du jour.
Je suis comme dans un rêve ;
Dans un coin si distant, si suprêmement reculé,
Je vois tes lumières.
Le jour s’éclaire,
Le lit de la rivière s’élargit,
Les montagnes battent en retraite,
Je peux toutes les voir désormais.
Cinquième.
Un toit sur un toit,
Des maisons construites avec les pierres sombres de la rivière,
Échelles avec des fenêtres aux multiples carreaux ;
Murs de fumier, motifs,
Noir froid, feu de bois,
Sombre, profondeur obscure du sol antique,
Quand le temps s’arrête, tout semble figé par le froid.
Des tombes émergeant de la neige comme des flèches tirées de droite et de gauche,
Je suis sur une de ces collines éloignée où les maisons reposent
Sur ces maisons.
Exclus des sommets, des tantes âgées font face aux montagnes opposées ;
Habituées aux jours qui s’écoulent au rythme du thé fumant,
Difficile à croire !
Je ne relève pas la tête ;
Je viens juste d’orienter les pentes face à moi,
J’ai pris la vallée dans ma main.
Le feu brûle à la pointe de mes yeux,
Deux mille ans sans extinction,
Du bleu – sortant du sol –
Ces oiseaux du ciel sont pour toi.
Sixième.
Je marche dans une rue large d’un pas – à un pas de la falaise
Les limites des champs s’étirent sur les pentes opposées ;
Comme des points de couture,
Divisant la froide couverture blanche.
Je reste là dans mon haleine froide.
Je me souviens des kalpacks caucasiens,
Bruits de cloches…
L’espace séparant les moutons agglutinés ;
Un bâton, un chien, un cardigan sur le dos du berger
Aucun arbre.
Ici, il n’y a que des branches.
L’aboiement du chien résonne,
Circule dans les collines,
Puis disparaît.
J’étais un peu effrayée, demandent mes lèvres ;
– Je veux aller plus haut
Vers cette fin infinie,
Comme s’il n’y avait rien au-delà, juste le fardeau du passé.
Impossible de sauter d’un sommet à l’autre ;
Toujours obligé de monter et descendre.
La route est droite pour atteindre ce qu’elle voit,
Apparemment ce n’est pas si facile.
Septième.
La nuit arrive soudainement,
Une couverture bleu sombre.
Les lumières sont allumées, les cheminées fument les unes après les autres,
Mes mains sont douloureuses à mesure que le sang les réchauffe.
Combien d’eau de fonte en hiver, combien de printemps sont passés…
Ce voyage temporel est tellement étrange ;
Je ne veux pas repartir.
Quelque chose joue dans mon oreille :
Noah dit que son langage est le nôtre ;
Personne ne sait, dit un homme d’ici,
Voilà sa cime, désigne-il, le bateau est là ;
Il y a aussi un lac, des bouts de bois flottent à la surface
Quand il essaye d’attraper (un morceau), celui-ci disparaît d’un bord à l’autre…
Les restes d’une épave
Il désigne un chemin :
C’est la voie du feu qui ne s’éteint jamais.
Je regarde à travers les maisons empilées sur une colline,
Autant de lumières de rue qu’on les compte sur les doigts,
Peut-être trois ou cinq, on dirait des torches au bout du pôle.
Je regarde une dernière fois en ouvrant la fenêtre.
Il faut que je rentre avant qu’il ne fasse trop sombre, sans rater le chemin dis-je.
Lentement, l’air glacial vous engourdit.
Huitième.
Nous repartons ébranlés.
Je vois le troupeau dévalant la montagne ;
Avant que le printemps ne revienne gonfler le lit (de la rivière)
Ils cherchent les derniers végétaux,
Regardent les branches mortes des baies…
À nouveau le crépuscule tombe doucement,
Combien de nuits dis-je ?
Je ferme les yeux ;
La vallée siffle dans mon oreille
Je ne comprends pas ce que j’entends.
3 avril 2020, Istanbul
Texte et photos : Nilüfer Karanfil-Büyükyıldırım.